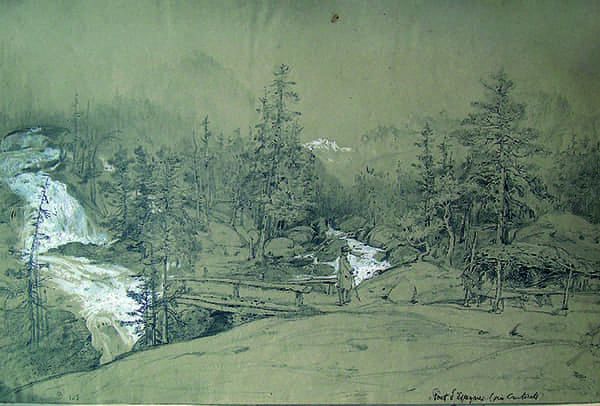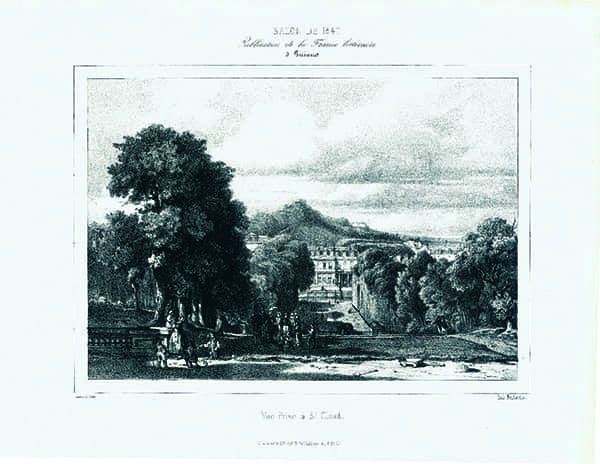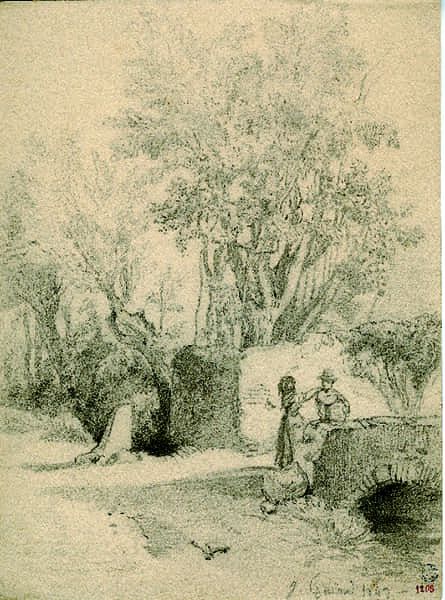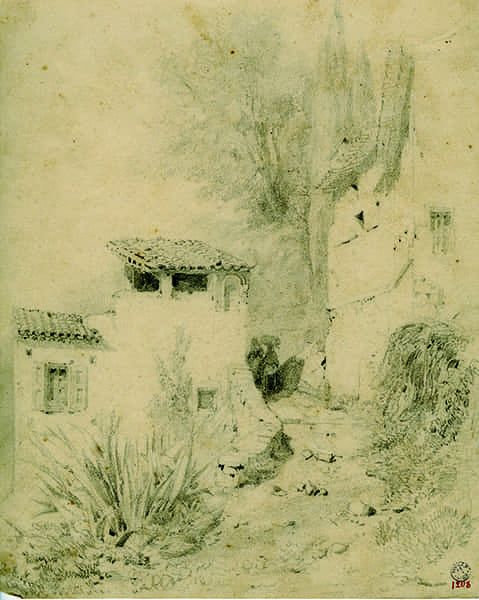Perspective, scénographie et paysage
Jacques Guiaud peintre paysagiste
par Mireille Lacave-Allemand
Historienne de l’Art
- Introduction
- PERSPECTIVE ET ARCHITECTURE : le cadre bâti privilégié
- - Églises et monuments : de la verticalité à une plus ample respiration
- - Théâtralisation du bâti
- - Villages « pittoresques »
- SCENES DE LA VIE QUOTIDIENNE
- - Mer, quais et pêcheurs
- - Scènes de la rue, métiers et marchés
- - De l’observation attentive de la rue naît le spectacle du monde
- PEINDRE AU NATUREL
- - Guiaud et l’essor des représentations de la nature
- - La Riviera : variations sur une nature non domestiquée
- - Le répertoire végétal
- GUIAUD « VEDUTISTE » ?
- Conclusion
-
![Pont d’Espagne, près Cauterets, Pyrénées.]()
Pont d’Espagne, près Cauterets, Pyrénées.
Technique mixte, crayon et craie blanche sur papier chamois par Jacques Guiaud, 1843.
H 31 x L 40 cm,
signé et daté b. g., localisé bas dr.
Collection particulière. -
![Vue prise à St. Cloud.]()
Vue prise à St. Cloud.
Lithographie de Jacques Guiaud.
Planche extraite de l’Album du Salon de 1840...,
Paris, Challamel, 1840. -
![Nice, étude.]()
Nice, étude.
Technique mixte, crayon et craie blanche par Jacques Guiaud, 1849.
H 14 x L 25,2 cm,
localisée et datée b. g., signé bas dr.
Nice, musée Masséna, n° inv MAH-1208-48.
Repr. © J.-P. Potron/Ville de Nice. -
![Nice, Saint-Barthélemy.]()
Nice, Saint-Barthélemy.
Crayon sur papier de Jacques Guiaud,
H 10,2 x L 16,5 cm.
Nice, musée Masséna, n° inv MAH-1108-23.
Repr. © J.-P. Potron/Ville de Nice. -
![Monaco depuis Sainte-Dévote.]()
Monaco depuis Sainte-Dévote.
Aquarelle sur papier de Jacques Guiaud.
H 23,5 x L 21,6 cm.
Nice, musée Masséna, n° inv. MAH-1201.
Repr. © J.-P. Potron/Ville de Nice. -
![La baie de Beaulieu.]()
La baie de Beaulieu.
Aquarelle sur papier de Jacques Guiaud.
H 25 x L 35,4 cm.
Nice, musée Masséna, n° inv. MAH-1207-2.
Repr. © J.-P. Potron/Ville de Nice. -
![Environs de Nice.]()
Environs de Nice.
Crayon sur papier chamois par Jacques Guiaud, 1847.
H 27 x L 20 cm.,
signé et daté b. dr., signé bas dr.
Nice, musée Masséna, n° inv MAH-1208-10.
Repr. © J.-P. Potron/Ville de Nice. -
![La route de Gênes.]()
La route de Gênes.
Crayon sur papier chamois par Jacques Guiaud.
H 25,4 x L 20,9 cm.
Nice, musée Masséna, n° inv. MAH-1208-1.
Repr. © J.-P. Potron/Ville de Nice.
Peindre au naturel
La Riviera : variations sur une nature non domestiquée
C’est ici, nous allons le voir, que « peindre au naturel » prend tout son sens. Si nous évoquons seulement la Riviera, c’est que celle-ci domine très largement l’oeuvre de paysagiste de Guiaud, à tout le moins dans ses aquarelles. Quelques rares exceptions cependant.
Des Pyrénées où il séjourne brièvement pour assister à l’inauguration de la statue d’Henri IV, il dessine les montagnes proches de Cauterets et, avec une profonde attention, les sombres mélèzes. Il rend la raideur des troncs, les aiguilles qui pendent, les troncs hérissés de branches mortes, et un vieux pont de bois dit Pont d’Espagne près de Cauterets. La scène est empreinte d’une belle sévérité. Au même moment son ami Justin Ouvrié s’en va faire des repérages à Eaux-Bonnes pour de grandes toiles dont l’une est exposée aujourd’hui au musée de Pau.
En Île de France, lorsque Guiaud y travaille, il représente l’un des châteaux royaux, La vue de Saint-Cloud, qui met au premier plan le parc avec ses grands arbres ainsi qu’un rassemblement d’hommes et de femmes de la bonne société, attirés par les facéties de quelques jeunes saltimbanques montreurs de singes. La vue en perspective est réalisée à la façon des peintres du XVIIIe ou du début du XIXe siècle, en particulier dans le traitement des feuillages42. Guiaud retrouvera la même vivacité, et le même classiscisme dans le traitement par grandes masses des feuillages dans la Vue de la tente du fils du sultan du Maroc, prise par le maréchal Bugeaud à la bataille d’Isly le 14 août 1844, exposée dans le jardin des Tuileries à Paris en septembre 184443.
L’arrivée dans le midi et le long séjour à Nice marquent un grand changement dans les goûts du peintre. De policée et de paisible, sa nature devient plus libre, plus « à l’abandon ». Son oeil retient les variétés endogènes, et garde un côté rustique, y compris lorsqu’il peint les espèces acclimatées sur ce littoral méditerranéen. Les cyprès voisinent avec les eucalyptus, les chênes avec les palmiers, l’aloès et l’agave avec le figuier de barbarie, l’oranger avec la vigne.
Parfois, l’artiste est séduit par le paisible jardin d’un couvent, comme celui de Saint-Barthélemy, avec un aloès dans un pot, des figuiers de barbarie, des cyprès, et dans la partie droite du dessin une plante grasse et peut être une vigne qui enrichit ce jardin de méditation. Par coquetterie peut être, Guiaud a dessiné un peintre de dos regardant le calme spectacle du jardin en contrebas.
Sur des aquarelles de la même époque librement brossées, des pins, des oliviers encadrent le paysage et s’ouvrent sur fond de mer. Il s’agit plus d’une mise en place des éléments constitutifs du paysage que d’un travail “fini”, même si l’aquarelle de Monaco depuis Sainte-Dévote est plus aboutie que celle de Saint-Jean-Cap-Ferrat, reproduites ici.
Lorsque Guiaud s’installe pour quelques années sur ce morceau de terre qui n’est plus la France et qui est déjà presque l’Italie, un engouement marqué pour les plantes exotiques est né avec l’art des jardins d’agrément. Pourtant, il faut bien remarquer que ces jardins sont rares dans l’oeuvre de Guiaud. Le peintre, arpenteur des vallons et des collines, ne paraît pas intéressé par « l’invention de la côte d’azur » selon l’expression d’un historien du tourisme44. En effet, ses dessins ne rendent qu’exceptionnellement compte de la diversité des espèces plantées ; ainsi, lorsque Guiaud dessine le jardin de la villa Arson, l’un des jardins parmi les plus élaborés de Nice, il est plutôt séduit par le fouillis de la végétation vu depuis la terrasse, que par les variétés que les jardiniers de la famille ont acclimatées. Sur un autre dessin, les jeunes femmes de la famille de Cessole sortent au jardin ; dans la grisaille de la mine de plomb, on distingue les cyprès et une tonnelle, le reste semble fait de laurier-rose et de plantes grasses éparses.
Guiaud ne semble pas avoir travaillé pour la clientèle britannique en résidence à Nice, dans le quartier de la Croix de Marbre et sur la promenade « des Anglais » ; toujours est-il qu’il ne semble pas avoir dessiné ou peint villas et jardins de la « colonie » des hivernants, comme la célèbre « villa de l’Anglais », véritable folie anglo-moghole, édifiée à partir de 185745. Pour Élisée Reclus, cette villa est l’une des plus fastueuses, « elle occupe une position magnifique, à l’extrémité méridionale du promontoire du Mont Boron, et commande une admirable vue de Nice ; mais elle est bien l’un des échantillons les plus ridicules du style baroque… Au-dessous de la villa des jardins suspendus, taillés à grands frais dans le rocher, descendent de terrasse en terrasse jusqu’à la mer ». On peut penser que Guiaud partageait l’opinion de Reclus, encore qu’il n’ait pas vu la villa totalement achevée. Et il nous semble clair que Guiaud n’est pas un fervent amateur des jardins organisés qui prétendent recréer la nature en acclimatant des espèces importées, et qu’il n’aime pas l’image de luxe que ces jardins reflètent et qui participeront à l’essor de l’horticulture niçoise en lien avec le tourisme.
De fait, Guiaud aime rendre le paysage de la nature « brute », sans apprêt. Pas plus que les jardins des anglais, il ne dessine les terrasses cultivées pourtant caractéristiques du pays. Jamais les vergers d’agrumes qui font la réputation des environs de Nice, jamais ou si peu les fleurs cultivées telles la rose ou l’oeillet. Son oeil n’est pas celui d’un botaniste, ni d’un jardinier ; il préfère capter les broussailles, les arbres, les herbes qui croissent sur les bords des chemins ou dans les cours de fermes que l’on croirait à l’abandon, tant est grand leur délabrement. Peut-être capte-t-il plus ou moins consciemment un changement de mode de vie, le passage d’une culture ancestrale, en fin de course, faute de s’adapter rapidement à une société mouvante en partie dominée par les hivernants qui dictent peu à peu leur règles, façonnent les modes et réclament des services, déstabilisant le mode de vie traditionnel.
Si le pays de Nice apparaît de plus en plus comme un pays de cocagne pour les oisifs, les cultures en terrasses disparaissent. Finie l’agriculture qui faisait vivre, chichement parfois, le paysan de Nice et des environs, finie la polyculture où côte à côte poussaient l’olivier, les fruitiers et les céréales. Place désormais à de nouveaux maîtres du jeu, qui, tel Alphonse Karr, journaliste pamphlétaire et jardinier à Nice, se lancent dans la culture des fleurs. La pression sur la terre s’accroît, retirant autant de surfaces de l’agriculture nourricière.
Guiaud a vu ces changements, mais il semble leur tourner le dos leur préférant la simplicité de la ruralité traditionnelle. Par un refus de considérer la rupture, son attention se porte donc aux plantes qui de tout temps ont été celles des pays méditerranéens : l’olivier, la vigne, le cyprès, les caroubiers et les chênes verts, arbres emblématiques des terres sèches des pentes escarpées, qui résistent au soleil et à l’absence d’eau.
Deux dessins permettent de comprendre ses choix et sa vision de la nature : le long de la Grande Corniche, sur la route étroite qui se fraie un chemin entre la montagne et les rochers, cheminent deux paysannes, un aloès pousse sur le bord de la pente, une maison est coincée contre la paroi rocheuse où s’accroche un arbre d’espèce indéterminée. Tout est dit en quelques traits de crayon, la sécheresse ambiante, la pauvreté des sols, l’étroitesse des terrains, le délabrement des maisons. Dans l’un des dessins, il exclut les figures, et il privilégie les plantes grasses qui s’agrippent aux rochers. Le mélange des espèces est significatif de son goût pour le naturel sans artifice ; voisinent ici les agaves, les aloès, les cyprès et un chêne (ou un olivier), des plantes sauvages qui poussent au hasard dans les interstices de la rocaille.
Ailleurs, il montre la rencontre de deux jeunes gens sur un vieux pont ombragé d’un bouquet d’arbres ou une vieille ferme qui tombe en ruines, ailleurs encore une tonnelle qui envahit une terrasse.
42 La lithographie reproduite ici est identique à son tableau du Salon de 1840 (n°785), intitulé Vue du château de Saint-Cloud, près de l’avenue conduisant à la lanterne de Diogène.
43 Cf. chap. Guiaud peintre d’histoire ; Versailles, musée d’Histoire, châteaux de Versailles et de Trianon, n° inv. MV 5568 B, INV 5249 B, LP 6304 B. Catalogue Constans n° d’ordre 2317. Salon de 1845, achat en 1845.
44 Bottaro (A.), “Villégiature anglaise et l’invention de la Côte d’Azur”, In Situ, 24, 2014, Architecture et urbanisme de villégiature : état de la recherche ; http://insitu.revues.org/11060.
45 Cf. Le Pays de Nice et ses peintres, op. cit., p. 268, n° 465, coll. part.
TOUTE REPRODUCTION TOTALE OU PARTIELLE EST INTERDITE.
Les articles et illustrations de l'ouvrage sont protégés par copyright. Les œuvres représentées sont autorisées uniquement pour l'ouvrage et le présent site internet. Pour toutes questions contacter l'Acadèmia Nissarda.